
 Struc. à petites
échelles
Struc. à petites
échelles
 Dans les régions calmes
Dans les régions calmes

 Struc. à petites
échelles
Struc. à petites
échelles
 Dans les régions calmes
Dans les régions calmes
Au niveau de la photosphère, les plus petites structures visibles en lumière blanche sont les pores. Ils peuvent être aussi sombre que les taches mais n'ont pas de pénombre et sont généralement beaucoup plus petits. Ils sont caractérisés par de rapides changements. Leur taille est celle d'une ou quelques granules (1" à 10", usuellement entre 2" et 5"). Leur durée de vie va de quelques heures au jour ce qui est comparable à la durée de vie des supergranules. Leur champ magnétique mesurable par effet Zeeman est de 0,15 T voire plus. Leur intensité est de 20 à 40 %celle de la photosphère. Ils peuvent marquer la position d'une tache en train de se former, ou apparaitre à l'intérieur d'un groupe de taches.
Les points magnétiques, pratiquement invisibles en lumière blanche, sont d'une structure magnétique semblable à celle des pores. Ces concentrations de flux magnétiques qui sont accompagnés d'une augmentation de la température produisent des trous dans les spectres solaires c'est-à-dire des changements dans les profils de raies. Les champs magnétiques estimés y sont de l'ordre de 0,1 à 0,2 T. Les points magnétiques sont très abondant au voisinage des taches et leur polarité est opposée à celle de la tache à laquel-le ils ``appartiennent''. Le flux magnétique de l'ensemble des points magnétiques est à peu près du même ordre de grandeur que celui de la tache. Ceci suggère que certaines des lignes de force quittent la tache pour revenir sur la surface et les points magnétiques seraient justement les endroits par où elles rentrent. La durée de vie de ces points est de l'ordre de l'heure. Ces points sont principalement associés à des mouvements descendants de la matière et se situent dans les régions intergranulaires.
Le champ magnétique des
plages n'est pas
homogène : le facteur de remplissage des régions magnétiques
dans les facules est inférieur à 0,5. Livingston et Harvey (1968)
suggèrent que le flux magnétique est quantifié dans les régions
hors taches : le flux serait de 2,8 Mx. Environ 90 %du
champ magnétique est convoyé par l'intermédiaire des tubes de flux.
L'apparence des régions actives changent avec l'altitude. Au niveau
de la photosphère, on observe des granules anormaux. Ce sont en
fait des granules mais l'espace entre eux est rempli de petites
structures de taille voisine de 0,25". Ces grains sont souvent
assemblés les uns aux autres et forment des structures de type
filamentaire qui sont appelées filigrés. Ces derniers sont
d'une taille inférieure à
300 km. Les petits grains sont les pieds des tubes de champ et ont
un flux de l'ordre de quelques
Mx. En prenant de l'altitude,
le diamètre de ces tubes de flux augmente jusqu'à 1000 km au maximum.
Au niveau de la chromosphère, les régions actives apparaissent
comme étant un assemblage de petits grains (Kitai et Muller 1984)
qui sont les parties froides des tubes de flux. Plus haut dans
l'atmosphère, la température
des tubes croit et ils émettent dans l'extrême ultra-violet. La
structure du tube demeure la même jusqu'à des températures de
7 à 8
K. La température d'un tube montant encore plus haut
excède
K et les tubes se rassemblent alors en botte ce qui
donne cet aspect caractéristique de la couronne observée en rayon-X.
En effet, au-dessus des régions sont observées des sortes des
``casques'' qui sont structurés par les champs magnétiques ouverts.
Les tubes de flux des facules sont en moyenne plus larges
que ceux du
réseau photosphérique.
La différence entre facule et réseau ne peut être
reproduite dans les modèles que si les tubes de flux des facules sont
plus froids de 600 K environ à une profondeur voisine
de l'épaisseur de la
dépression de Wilson au-dessous de
. Solanki et Stenflo
(1984) utilisent des méthodes statistiques pour séparer les différentes
conditions physiques dans les tubes de flux sur les paramètres des raies.
La différence de température trouvée entre tube de flux des
facules et du réseau ne peut pas s'expliquer par des facteurs de
remplissage différents dans l'une ou l'autre région. Pour les modèles
l'accroissement de température est de l'ordre de 400 à 600 K pour
les tubes de flux du réseau et de 100 K pour ceux des facules à
.
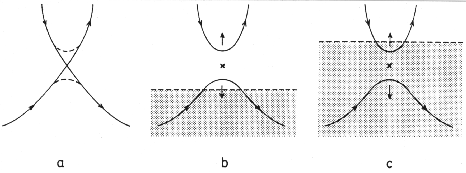
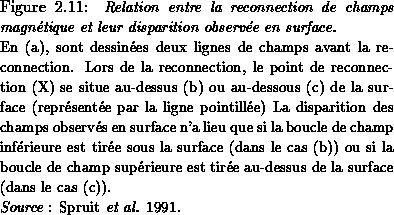

 Struct. à petites
échelles
Struct. à petites
échelles
 Dans les régions calmes
Dans les régions calmes
vig@