 6.3.1 Influence des taches
6.3.1 Influence des taches
 6.3.3 La troisième composante
6.3.3 La troisième composante
 6.3 Comment expliquer ...
6.3 Comment expliquer ...
Les facules, éléments de la photosphère composées des petits tubes de flux de champs magnétiques de l'ordre du kGauss, ont un effet inverse de celui des taches puisqu'elles augmentent l'irradiance. Foukal et Lean (1986) montrent en effet que l'irradiance corrigée de l'effet des taches est en relativement bon accord avec l'évolution temporelle de l'aire des facules représentée par l'aire des plages observées dans la raie K du calcium II pondérées par une fonction du contraste des facules près du limbe. L'étude de leur contribution à la variation de l'irradiance est cependant difficile en particulier parce que le contraste des facules par rapport à la photosphère non perturbée est fonction de leur distance au centre du disque et parce que cette relation est mal connue. La valeur du contraste est comprise entre 3 %au limbe d'après les observations de Chapman et Ziegler (1993) et de 11 %d'après celles de Foukal et al. (1993). Tous s'accordent à peu près pour dire que le contraste est très faible (inférieur à 1 %) au centre du disque. Par ailleurs, ce contraste varie avec la longueur d'onde. C'est pourquoi il est relativement difficile de construire un indice tel que le PSI pour estimer l'effet des facules.
Sur des échelles de temps de l'ordre de l'évolution des régions
actives (6 mois environ), la réduction de l'irradiance par
les taches est comparable à
l'excès de flux provenant des facules (Foukal et Lean 1986, Lawrence et
Chapman 1990). En effet, si le contraste des taches par rapport à la
photosphère est environ 10 fois celui des facules (Lean 1991),
ces dernières couvrent au moins 10 fois plus de surface que les taches
(Chapman et al. 1993) et restent 2 à 4 fois plus longtemps sur le
disque que les taches. Notons cependant que Chapman et al. (1993)
ont montré que
le rapport entre l'aire des taches et des facules n'était pas constant et
qu'il augmentait entre 1988 et 1994 (intervalle de temps sur lequel a porté
leur étude). Foukal et Lean (1986) ont suggéré que cet équilibre entre
taches et facules n'était qu'apparent et qu'il n'impliquait pas que le
flux bloqué par les taches ressortait par les facules. Leur résultat est en
contradiction avec celui de Chapman et al. (1986). Ces derniers,
en étudiant, d'une part,
l'irradiance photométrique
mesurée à l'observatoire de San Fernando, et d'autre part,
les contributions des taches (représentées par leurs aires)
et celles des facules (représentées par l'aire des
plages dans la raie K du calcium II), trouvent qu'une
majeure partie du flux bloqué par les taches ressurgit dans les facules.
La théorie prédit cependant que seulement 5 %du flux bloqué par les
taches réappatra^t à la surface sur des échelles de temps inférieures
à
10 ans, si le
blocage du flux se fait sur des profondeurs supérieures
à 1000 km (Spruit 1982).
De plus, la faible partie du flux qui atteint la surface
le fait près de la tache ou des facules avoisinantes. C'est donc le flux
bloqué par les taches il y a quelques cent mille ans, qui ressurgit
aujourd'hui, possiblement sous des formes non magnétiques (Spruit 1994).
Ainsi que cela est mis en évidence sur la figure
6.5,
l'irradiance corrigée de l'effet des taches est en relativement bon
accord avec l'évolution temporelle de différents indices tels celui de la
raie K du calcium II (393,2 nm), de la raie de l'hélium neutre (1083 nm),
de celui du rapport centre-bord du magnésium II (280 nm, voir paragraphe 6.4)
ou encore de la raie Lyman-
(121,6 nm). Ces indices
de l'activité, bien qu'ayant une origine chromosphérique,
sont d'assez bons indicateurs des éléments brillants photosphériques.
Cet accord entre
les séries temporelles, valables pour des échelles de temps de l'ordre de
l'évolution des régions actives, ne l'est plus dès lors que l'on
s'intéresse au cycle de 11 ans. Les maximums et le minimum de l'irradiance
corrigée par le
PSI sont en effet mal représentés par les indicateurs de facules
(Livingston 1992, Pap et al. 1994, Fröhlich 1994, figure
6.6).
Donc, si facules et taches ont des contributions du même
ordre de grandeur sur des échelles de temps de quatre à
neuf mois et si elles
n'expliquent pas toute la variation de l'irradiance sur 11 ans, c'est qu'il
existe une autre composante influençant l'irradiance à long terme.
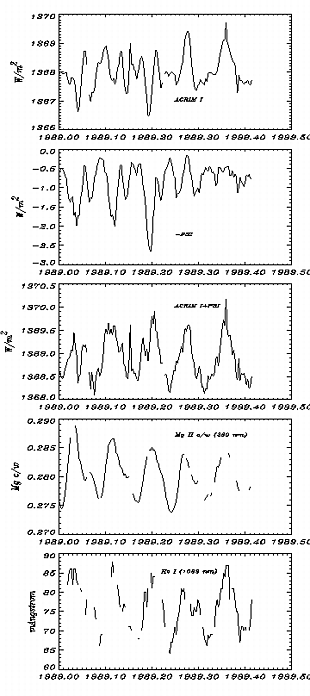
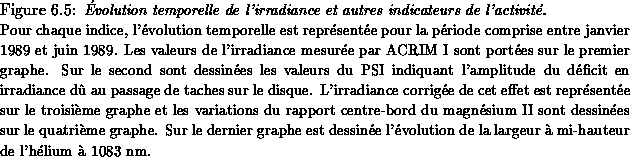
 6.3.1 Influence des taches
6.3.1 Influence des taches
 6.3.3 La troisième composante
6.3.3 La troisième composante
 6.3 Comment expliquer ...
6.3 Comment expliquer ...
vig@